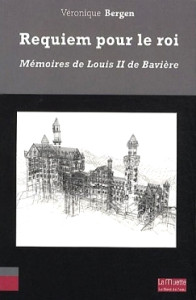Par Athane Adrahane (2011)
Véronique,
Je viens de terminer « Requiem pour le roi ».
Je voudrais t’écrire depuis ce point où tourbillonnent les âges, les sexes et les règnes, où s’étreignent les astres, les fleurs et les lacs.
Je voudrais t’écrire depuis ce point où existe le mouvement d’aller retour incessant entre esprit et matière, nature et pensée, noûs et phusis.
En toute immanence.
Je voudrais t’écrire depuis ce foyer de solitude, ce royaume de l’enfance où le pouvoir de l’imaginaire sait résister à la réal politique des adultes.
Depuis le point que ton livre allume, je ne peux en cette nuit t’esquisser que quelques sentiments en éclair…
Saisie magnétiquement par le devenir que tu extrais de l’histoire de ce roi sculpté dans une solitude de haute altitude. Sa délitescence. Son déchirement, dans le sens des strates qui bâtirent son être. Son effeuillage, par où sa flore s’expose au charme lunaire, à son cortège d’ombre favorisant d’autres enfantements. Et ce, que le magnétisme soit de cime ou d’abîme, porteur de marée de peur ou de ruissellement d’extase.
Par arrêt de la clepsydre, la mesure humaine du temps qui domestique les éléments, ton espace littéraire révèle l’autre royaume, lève les doubles. Inversion du cours de l’histoire où en suivant les lignes de failles, emporté par tes coulées de phrases s’opère la remontée, strate par strate, à la composition aurorale qu’inaugure la note bleue.
Débordant le lit du pensable, ton écriture se pare du double mouvement qui fait danser ensemble la vie et la mort. Ton livre devient ce passeur où le dernier souffle converse avec le premier libérant la partition aux multiples durées, portées qu’aspire et expire une vie.
À la question, « pourquoi la serrure des naissances ne s’ouvre-t-elle qu’avec la clef du trépas? » (Palimpsestes).
J’ai essayé et te le confirme: avec ton écriture aussi elle s’ouvre, la serrure des naissances.
De l’autre naissance. Véritable palimpseste.
Forgée dans l’athanor transcendantal, ta clef verbale opère le geste de soliquéfier et de liquédifier.
Ton écriture fait toucher la compression, la dilatation propre au processus métamorphique.
Elle… je m’arrête là car je ne peux tenir plus loin ce point depuis lequel j’embrasse ta montagne, ses rivières aux accents de fleur en chemin vers les étoiles.
Athane
Athane Adrahane : Espace-temps ? Si le cadre de ton roman est historique, « Louis II, roi de Bavière », qu’il s’ancre au 19ème siècle, au temps de Wagner, de l’annexion de la Bavière par la Prusse, de la fondation de l’empire allemand, on assiste tout au long du livre à de nombreux décadrages où se déploie le temps des devenirs, des affects, des rêves. Louis II, exécrant la tournure que prend son époque régie par la guerre et le capitalisme naissant, largue souvent les amarres pour ancrer d’autres devenirs que celui de sa fonction historique. En ces devenirs, la grammaire y est celles d’éros, de la lune, des forêts, des lacs, des roses, des pierres, de la chair et des dieux. La partition extrêmement intime et solitaire que tu exécutes n’est pas celle d’un monologue intérieur mais plutôt une polyphonie où s’interpénètre une multiplicité de langages, où se tente, il me semble, un dialogue à la frontière des sexes, des règnes et des époques… Ces portes temporelles où communiquent entre elles plusieurs époques, divers règnes habitent tes romans (Fleuve de cendre, Kaspar Hauser), tes poèmes ainsi que tes personnages qui ne cessent d’expérimenter cette porosité des espaces/temps, ces passages entre les divers langues du royaume du vivant, mais aussi des morts (Sissi, Chloé, Ambre, Kaspar, Louis II). Peux-tu nous parler de cette « stéréo-perception », perception en surround, écho-perception du spatio-temporel?
Véronique Bergen : Je pense que l’espace du roman, de la création en général appelle en sa construction le lever de ces espaces/temps fibrés, circulaires où se lèvent les puissances des devenirs. Toute œuvre fait jaillir des temps de vie, des temps de rêves, des temps d’enfance qui court-circuitent, bousculent l’écoulement monolithique de Cronos. Dans la figure de Louis II de Bavière, son expérimentation de vies alternatives, ses déports et envols dans les micro-mondes de la musique, de l’érotisme, des châteaux se plaçaient sous le signe d’un irrépressible sursaut pour ne pas périr sous le coup d’une réalité historico-existentielle qui l’asphyxiait. Louis II est un opéra à lui seul. Une pluralité de créatures féminines, angéliques, animales, d’éléments naturels règne en lui : au-delà du « Je est un autre », il se compose d’une foule d’êtres, il est un expert des passages, il est dysphorique, il cherche une issue hors de l’assignation à une identité royale, masculine qui brime ses tribus. La plupart de mes personnages, Louis II, Sissi, Kaspar Hauser, Chloé passent des alliances avec la vie qui impliquent de voyager dans les plis du temps d’avant, de s’ouvrir à des noces avec d’autres règnes, animal, végétal, minéral, de laisser monter en eux les voix des absents, des morts, du disparu, de la foudre, de l’aurore de l’expérience. Non que le présent soit trop étroit : il se diffracte en sous-temporalités multiples, composées de strates qui le déboîtent vers l’avant, l’après, le cosmos. C’est parfois la teneur d’insupportable, de violence du temps historique qui pousse à la création d’autres royaumes. Et pour les personnages et pour le créateur, il en va souvent d’un mouvement de survie, de contre-mort, d’un réflexe libératoire placé sous le signe deleuzien « du possible, sinon j’étouffe ». Tracer, bâtir d’autres espaces-temps pour que l’adversité du réel n’ait pas raison de nous. Il en va d’une conduite magique, d’une création de possibles où habiter lorsque l’on bute (au dehors ou en dedans de soi) sur l’inhabitable, l’inintégrable. Il s’agit alors des mille et une danses qu’on esquisse pour sortir de la crise, faire rebondir l’intense, relancer les dés, gagner les cimes. Chevaucher des époques, prendre Cronos de court, c’est s’avancer dans d’autres régimes de sentir, de penser, de vivre, monnayer des rapports neufs de soi à soi, entre soi et le registre du dehors. Une nécessité régit ces « stéréo-perceptions » comme tu les appelles : celle de riposter à un point d’horreur, d’effondrement. Le verbe, les livres, la musique, l’érotisme, les paradis artificiels sont autant de réponses à la menace de dislocation, autant de tentatives d’arracher la vie à ce qui l’emprisonne et la violente.
A. A. : Art-corps ? Cette quête de la fièvre de l’infini, de la morsure vitale, d’un « corps sans organes », où se déformerait le corps en sa fonction, son organisation humaine pour une autre articulation de ses membres, un autre paysage de ses intensités, dans ton livre, Louis II l’expérimente par la musique, les célébrations érotiques, l’architecture de châteaux. Sont-ce là des lieux propices à la mise en danse, à la convocation des diverses temporalités qui le traversent ? On assiste là à une série de doubles mouvements, mise à mort et mise à vie, mouvement de remembrement et de délitement, extase et terreur, échec et nouvelle métamorphose, comme celle de la femme-lune…
V. B. : L’élection par Louis II de Bavière de contre-mondes en marge du protocole impérial, d’univers enchantés à l’écart d’une époque ravagée par la montée en puissance de la Prusse et l’hégémonie du capital répond à un double geste : d’une part, à une composante ludique, jouissive, exploratoire de sonder la vie sous l’angle du plus intense, de l’absolu, d’autre part, à un mécanisme de défense, à la mise en place affolée de terres où s’échapper alors que l’oppression du dehors conjointe à une désagrégation intérieure lui font perdre pied. Cette même double valence, on la retrouve, bien qu’innervée par d’autres ingrédients, chez sa cousine Sissi, Élisabeth d’Autriche. Dans le chef de Louis II de Bavière, la recherche solaire d’embrasements, l’avidité à connaître l’extase font place peu à peu à la panique de qui cherche à tracer des lignes de fuite dans son siècle haï, à révoquer son corps de roi, de mâle, dans une tentative de naître de lui-même, de s’auto-engendrer, devenant fils de lui-même, délié de sa génitrice ogresse, de son géniteur falot, dans une course contre la montre afin de n’être frappé par la folie qui frappe son frère Othon, qui décapite la branche maternelle des Hohenzollern et la branche paternelle des Wittelsbach. Cette rupture progressive avec le monde, cette noyade dans des voix de fantasmes et de fantômes que Louis II n’arrive plus à composer, le Ludwig de Visconti le montre magistralement. Rien ne garantit en effet que ces devenirs, ces métamorphoses expérimentées sans relâche tiendront, qu’elles doteront Louis II d’un corps d’enfance, d’un corps de femme. Dans la partie d’échecs qui se joue entre lui et son siècle pré-capitaliste et militaire, les armes de l’imaginaire, de l’extravagance seront défaites, réduites à quia par la raison d’État qui déposera Louis II, figure absolue de la victime du grand enfermement des réfractaires, du bâillonnement des explorateurs et passeurs de frontières.
A. A. : Dead can dance ? La partie d’échecs finale, où se livre la dernière danse du roi, est très intense en ce qu’elle parvient à exprimer l’impensable, à savoir le dialogue entre les diverses couches et régions qui façonnent l’énigme de tout être, s’y joue une musique où se joignent temps de l’enfance et de l’adulte, notes d’eau et de feu. On y sent le concept de double mort (Blanchot, Deleuze), la libération des souffles qui sculptent une vie, leurs retours à la « respiration primordiale ». Rainer Maria Rilke parle de la grande mort que l’on porte en soi à la façon d’un fruit que l’on cultive tout au long de notre vie et qui un jour parvenu à maturation pourrait éclore, plein d’échos comme un jardin où ressusciterait le temps de l’enfance, celui de l’émerveillement. Ceci fait aussi écho à la fin de ton Kaspar où, après sa dernière bataille, il fusionne avec le vent et son cheval blanc. Peut-être que cette éclosion est prématurée ou qu’elle vient « trop tard ». « Trop tard » en tant que cette dimension du temps où se fait l’alliance de l’homme avec la nature comme dit Deleuze dans l’Image-Temps. Trop tard en tant que cette « sublime clarté » qui s’oppose à l’opaque. Louis II fusionnant avec les étoiles lacustres, touche enfin à l’apaisement de sa guerre intérieure. Quoi qu’il en soit, ces fissurations de lumière ne cessent d’opérer à même les descentes abyssales, hadales de tes personnages, chaque page nous livre sa dose d’incandescence, de sublimation de la confusion en lucidité sans complaisance. Ton écriture qui semble s’être construite à même l’urgence de tels questionnements, produit des clefs capables d’ouvrir sur cette alliance avec les éléments (union sensible, sensuelle). Ton requiem est donc loin d’enfermer le lecteur dans une messe de mort, au contraire à la façon d’une musique de Dead Can Dance, par les fulgurations d’absolu qui coule à travers tes phrases, il y a possibilité de penser les impensables, de libérer le questionnement plus que vital d’un comment parvenir à apprivoiser la danse de l’existence en ses souffles pluriels, en ses chants d’ombres et de lumières, ses clartés et ses opacités, d’un comment voir le jaillissement de ces divers tempi et d’en exercer la danse, à même la vie, sans pour autant s’effondrer dans le chaos d’une folie mortifère.
V. B. : Sartre a fait de la mort celle qui arrive toujours trop tôt ou trop tard, la définissant comme lucarne absolue sur l’en soi. Mais dans les finales de Kaspar Hauser, de Requiem pour le roi, aussi de Fleuve de cendres, d’Aujourd’hui la révolution, la mort qui rapte Kaspar fusionnant avec la neige, son cheval, celle qui prend le visage aquatique d’un lac qui se referme sur Louis II, d’une rivière qui ophélise Ilse, la strangulation par laquelle on assassine Ulrike Meinhof relèvent, comme tu le perçois, du concept blanchottien-deleuzien de double mort. D’une part, la mort molaire qui signe le retour à l’inanimé, le ressac de l’en soi sur le pour soi, le retournement du coefficient d’adversité sur le sujet, d’autre part, la libération des doubles, des flux impersonnels, l’immersion panthéiste dans un tout qui reconnecte l’individu aux forces du cosmos. Lorsque je me plonge dans la mise en mots, en mouvements graphiques de la mort d’un personnage, c’est à mon insu, par devers moi qu’elle prend souvent la forme d’une connexion, d’un court-circuit entre la fin qui se profile, le terminus qui se dessine et une remontée d’enfance. Rien de délibéré, de proto-conceptuel, de mûrement réfléchi là-dedans. Il se fait que, au fil de la narration hallucinée de la mort, la montée de cette dernière se double d’une remontée du passé, charrie des soulèvements de blocs d’enfance, blocs d’enfance qui, en dehors du terminus existentiel, ne cessent de venir trouer le présent poreux, diasporique des personnages. C’est a posteriori que je décèle dans plusieurs de mes textes un tissage serré entre entrée dans la disparition et éclosion de souvenirs involontaires, de réminiscences épiphaniques, de condensés d’affects échappés du jadis. Une filiation élective me relie sans conteste à ce topos proustien. Le réveil d’une empreinte sensitive passée dans l’enclave du présent alors que rien n’en annonçait l’avènement, et les personnages et l’écrivain en font l’expérience. C’est en ces zones d’invasions temporelles que l’écriture se tient, se joue pour moi, lorsque des devenirs, fussent-ils d’un passé qui n’a jamais été vécu, d’un passé en soi comme Deleuze l’a cerné chez Proust, percutent la perception présente. Tout un peuplement qui se déverse dans les sens et se traduit en lignes de vocables, en partitions de mots. Que la mort, cette « paix dans les brisements », vienne immanquablement trop tôt ou trop tard, oui, dans le sens où elle ne rédime, rachète rien, mais en dépouillant cette dys-chronie de son aura de nostalgie, d’élégie où poussent les fleurs du regret.
A. A. : Matière et esprit ? Tes romans sont de véritables traversées du corps et de l’esprit. Le mouvement de l’un à l’autre y est incessant. Tes romans sont à la fois terriblement charnels et peuplés d’entités philosophiques. Tu ne poses pas ton regard sur le minéral, sur l’océan, sur les n sexes dans un sujet, sur l’enfant sauvage mais il y a le regard minéral qui scrute le lecteur, l’océan qui a son mot à dire, l’enfant sauvage qui fait séisme dans l’adulte civilisé. On dirait que si un affect d’étoile s’empare de toi, il te somme d’exposer sa logique jusqu’au bout et cela dans son alphabet à lui. Où se situe l’alliance ? Comment reviens-tu de ces transes? Tu es philosophe mais on n’a pas l’impression que tu plaques des théories, des concepts sur des affects, l’un et l’autre semblent se co-créer, entrer en coalescence. Comment effectues-tu la jonction entre la philosophie et le langage des affects ?
V. B. : Dans l’espace du roman, les tensions qui agitent les lieux, les devenirs qui emportent les personnages doivent, me semble-t-il, traverser le corps des vocables, dans un aller-retour de ce qui est phrasé à la matière qui le phrase. Le monde des affects qui y est exploré est un monde où les partages usuels, les divisions officielles et les lois qui les régissent n’ont plus cours. Faire sortir des alphabets inédits, soulever les tropismes, les voix de l’enfance, les cris de l’animal, du cosmos requiert de desceller le prédicatif afin de descendre dans son avant, son dehors, de griffer, d’ensauvager les concepts par les flux des pulsions, d’ouvrir le verbe à l’irruption de ses n langues. Écrire, c’est explorer ce qui se tient sous les mots, sous le visible et le pensable, là où les coutures du déjà-dit, des possibles répertoriés craquent, c’est injecter le non domestiqué, le pré-symbolique, l’illimitation de l’enfance dans les codes du vivre et du créer. Le traitement que le roman, la poésie imposent au concept relève de son hybridation avec l’affect, de son éclatement sous des blocs de sensations qui le déportent, le désaxent. On y trouve non pas des inventions conceptuelles articulées sur un problème mais des concepts tremblés, ouverts sur ce qui les connecte à l’inconscient, à l’avant-homme, aux zones de passage. Le problème est moins de revenir de ces transes qu’expérimentent à la fois les personnages, le verbe et l’auteur que de composer la logique, la grammaire de ces perceptions en roue libre, de trouver les trajets qui relient les dynamismes intensifs. Il ne s’agit pas de parler de l’enfant sauvage, du monde antérieur aux mots, de la Shoah, des puissances de l’érotisme selon un point de vue de surplomb mais bien de parler de l’intérieur de devenirs qui ricochent de l’écrivain à la langue, de la langue aux personnages : la littérature ne se conquiert qu’à se tenir là, à hauteur de cet enjeu. L’art explore les mille et un états du corps, crée d’autres mondes, féconde les langues données par des registres formels en avance, en décalage par rapport au dire, à l’entendre, au voir. La composition romanesque n’est pas étrangère au labeur de la taupe qui creuse sous le visible des galeries qui font fi des cartographies des terres déjà balisées. L’écrivain invente une mise en forme, une mise en sons, en rythme des forces qui trouent le texte, qui balaient la page, il avance à tâtons, les sens aiguisés, aimantés afin de convoquer la voix de ce qui a été brimé, la voix de la fêlure, la voix de l’absence, de l’image en fuite, il tourne autour d’un point de faille, de crise, d’étrangeté qu’il ne cesse d’aménager, d’apprivoiser, un point qui se tient, tel un motif dans le tapis, mis en abîme, enfoui dans le texte. Au niveau des personnages, leur être-au-texte repose également sur un événement ombilical en pointillé, toujours devant eux car en arrière d’eux-mêmes. En quelque sorte, on peut parler d’une scène fondatrice mais prise dans des remaniements, des dynamismes incessants, à la fois structurelle, figée et mouvante, à la fois actuelle, vécue et virtuelle, agissante et désactivée, contre-effectuée. Les passages entre les terres de la philosophie et les blocs des affects, je ne m’interroge pas sur leur singularité, leur émergence, c’est d’emblée que les visions qui se découpent dans l’à-peu près charrient des entités conceptuelles transies, percutées par de l’infra- ou du para-conceptuel.
A. A. : Guerre et amour? À la perversion de la guerre et à celle de l’économie capitaliste non moins tueuse de vies fait front le rêve d’un théâtre de l’amour avec ces vertiges de cime, ses tumultes d’abîme… La contre-effectuation de la guerre par l’amour était saisissante dans « Fleuve de cendre » où alternaient scènes de mort programmée (les camps) et scènes d’amour enfantées à dimension d’infini (Chloé, Ambre, Ilse)… Cette contre-effectuation fera sourire les cyniques et les adultes, trop adultes. Or tarir cette puissance d’aimer est cela que vise le poison du capitalisme. Son art étant de séparer les gens de leur force d’aimer, de les diviser, de les dresser l’un contre l’autre, de les faire tomber dans le ressentiment. Il y a dans tes livres ce contre-poison, cette mise en contact avec la puissance d’aimer, source d’oxygène et vecteur redoutable de création, merci…
V. B. : Les créations philosophiques, esthétiques comme propositions de mondes qui redéfinissent l’état de choses empêchent le réel de se refermer sur le ronronnement des moyens et des fins, font pièce au bio-pouvoir, chacune à son échelle, du geste le plus ténu d’une résistance à la mise en œuvre de contrepoints, de contrepoids à effets révolutionnaires. Le geste de créer ne va pas sans parier pour le lancer de lignes de vie, sans contrer, s’opposer à tout ce qui contribue à épandre des lignes de mort, d’oppression, empêchant que le pouvoir ne muselle nos puissances, que les bien-fondés de pouvoir, commis d’état, oligarques imposant un capitalisme dévastateur n’aient les coudées franches. Un art émeute en son surgissement même, et surtout en ses impacts, un art qui permette à la société civile de se réapproprier les puissances de ses voix, de ses actes, de ne pas avaliser le présent et l’avenir qu’une poignée de maîtres du monde nous prépare à notre corps défendant, un art qui soit une ligne de feu qui fasse trembler les grands vassaux du capital, les Big Brothers travaillant à propager le degré zéro de la pensée, à réprimer les multiplicités fibrées des choix existentiels pour les couler dans le moule du Nouvel Ordre Mondial liberticide, il n’y a pas d’autre urgence. Merci à toi, Athane.
Octobre 2011.
Requiem pour le roi, Mémoire de Louis II de Bavière, Éd.Le bord de l’eau/La muette, 2011.
Véronique Bergen est philosophe et écrivain. Elle est l’auteur d’une oeuvre poétique abondante, ainsi que de plusieurs romans (dont Kaspar Hauser, ou la phrase préférée du vent, Denoel, 2006; Fleuve de cendres, Denoel, 2008), et trois essais: Jean Genet entre mythe et réalité (De Boeck, 1993), L’ontologie de Gilles Deleuze (L’harmattan, 2001) et Résistance philosophique (PUF, 2009).